Le débat sur la légalisation de l’avortement médicalisé au Sénégal prend de l’ampleur, confronté à des réalités dramatiques et à une législation restrictive. Pour les militantes et militants des droits des femmes, les nombreux cas de viols suivis de grossesses, parfois chez des mineures, révèlent l’urgence d’un changement législatif pour garantir la santé et les droits des femmes. Malgré la ratification du Protocole de Maputo par le Sénégal en 2004, l’interdiction de l’avortement demeure, mettant en lumière les tensions entre les normes juridiques, religieuses et sociétales, et les revendications des défenseurs des droits des femmes.
« Une jeune fille mineure, atteinte de handicap physique et de déficience mentale très sévères, a été victime d’un viol suivi de grossesse à Matam (nord). Cette gamine est incapable de faire quoi que ce soit toute seule; d’ailleurs, elle porte des couches depuis sa naissance. Elle a accouché d’une petite fille par césarienne et sa mère, qui s’occupe d’elle depuis toujours, doit désormais aussi prendre soin du bébé tout en continuant à s’occuper de sa fille handicapée. »
C’est par ce récit glaçant que Jaly Badiane, fervente défenseure des droits des femmes, décrit l’horreur vécue par cette victime de viol suivi de grossesse sur son compte X, anciennement Twitter, le 31 août 2024. Ce témoignage a déclenché une vague d’indignations sur le réseau social, les unes plus virulentes que les autres, demandant l’arrestation de l’auteur et une peine exemplaire. Dans les réactions, le sentiment de résignation se fait ressentir : « Et rien ne sera fait pour identifier ce violeur, ce criminel. La famille va le protéger, et donc les horreurs continuent », écrit Louise Faye.
D’autres cas similaires sont recensés un peu partout au Sénégal. En février 2014, dans la ville de Ziguinchor, dans le sud-ouest du pays, une fillette de 11 ans a donné naissance à des jumeaux après avoir été violée à l’âge de 10 ans, selon un rapport publié conjointement par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) et la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH).
Une législation stricte décriée
Entre janvier 2016 et janvier 2017, le Centre de Guidance Infantile et Familiale de Dakar (CEGID) a enregistré 97 cas de viols ou d’incestes sur mineures et 21 cas de viols suivis de grossesse, avec une moyenne d’âge de 11 ans, uniquement dans la région de Dakar. Le dernier cas en date ayant suscité l’émoi et relancé le débat sur le droit à l’avortement médicalisé date de décembre 2024. À Joal, située à 100 kilomètres de Dakar, une fillette de 9 ans attend un enfant après avoir été violée par son maître coranique.
Plusieurs activistes, militantes des associations de défense des droits de la femme, ont déploré le fait que la jeune fille soit condamnée par une législation stricte à garder sa grossesse. Le combat pour la légalisation de l’avortement au Sénégal reste un combat ardu et tenace. « Bien qu’il existe des groupes et associations féministes qui sensibilisent sur les droits sexuels et reproductifs, il existe toujours des barrières socioculturelles et religieuses qui bloquent les progrès en matière de plaidoyer », a expliqué la Secrétaire générale adjointe Sénégal d’Actions féministes (SENAF), Aminata Geneviève Sané. Elle pointe un manque de soutien institutionnel.
« Pour le moment, l’État montre une grande réticence, peut-être par crainte de froisser les sensibilités religieuses ou l’opinion populaire. L’Etat du Sénégal n’est jusqu’à présent pas prêt à légaliser l’avortement sécurisé. Et c’est déplorable parce que cette question est purement politique. En un claquement de doigt, l’Etat pourrait sauver des vies de beaucoup de femmes», ajoute Mme Sané.
Au Sénégal, bien que le pays ait ratifié la Charte africaine des droits de la femme en Afrique, connue sous le nom de Protocole de Maputo, qui reconnaît comme un droit fondamental l’accès à l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste ou lorsque la grossesse met en danger la santé mentale, physique ou la vie de la mère ou du fœtus, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) reste interdite par la loi.
Le Code pénal, en son article 305, qualifie l’avortement de délit passible d’amendes et de peines d’emprisonnement pour les femmes y ayant eu recours ainsi que pour les personnes qui l’ont pratiqué. Toutefois, une seule exception est prévue : en cas de danger pour la vie de la mère. Cette dérogation est inscrite dans l’article 35 du Code de déontologie médicale, qui stipule : « Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère ».
Le poids des perceptions
Au-delà des écueils relevant du cadre juridique, il y a les perceptions religieuses dans la construction des normes sociales liées à l’avortement. « On nous pose souvent l’argument religieux. Il y a une partie de religieux qui nous dit qu’il est interdit en Islam de mettre fin à la vie d’un être humain. Cet argument est profondément ancré dans plusieurs consciences de nos concitoyens. C’est un argument qui est véhiculé à grande échelle. Cela fait partie des premiers freins de notre plaidoyer », souligne la journaliste et militante des droits des femmes, Ndèye Fatou Diery Diagne.
« Certaines organisations qui se positionnent comme gardiennes des « valeurs » n’hésiteront pas à monter une cabale pour déstabiliser tout effort de plaidoyer, sensibilisation ou réseautage. À part ces stéréotypes structurels, il y a aussi les freins conjoncturels liés aux clichés sociétaux, à la stigmatisation des porteurs de tel plaidoyer », déplore Mamadou Lamine Diagne, coordinateur de l’initiative «Ois’eau» en Afrique.
Son organisation a été témoin, en 2010, d’un cas d’inceste sur une fille. « Son père biologique, l’auteur de la grossesse, a accepté sans rechigner. La fille a tenté de se suicider ainsi que sa maman en vain. Lorsque l’histoire est tombée entre les mains de l’autorité judiciaire, il était interdit à la fille d’enlever la grossesse parce que c’est prohibé par la loi tant que la santé de la mère n’est pas menacée. Ainsi, la fille a donné naissance à un garçon, « cadeau d’enfer entre ses mains », qu’elle sera condamnée à entretenir toute sa vie », raconte M. Diagne, dépité.
En islam, il y a des divergences concernant le recours à l’avortement, nous précise, d’emblée, Oustaz Mouhamed Al Amine Niang du Daara Al Amine Academy.
Mais, affirme-t-il, tous les savants de l’Islam s’accordent sur un fait : quand la femme est enceinte d’une grossesse atteignant 120 jours, il lui est strictement interdit de recourir à un avortement quelles que soient les circonstances. « Parce que c’est à partir de 120 jours que l’âme est insufflée dans le fœtus. Et à partir de ce moment, on considère que la femme porte dans son ventre un être humain à part entière qui jouit des mêmes droits que tout le monde. Et donc recourir à l’avortement à partir du 120e jour de grossesse et au-delà équivaudrait à commettre un homicide en Islam », explique Oustaz Niang.
Cependant, des divergences sont notées concernant le recours à l’avortement avant cette période des 120 jours. Certains doctes sont radicaux sur le sujet. Selon eux, aucune raison n’est valable pour justifier un avortement, même en deçà de la période des 120 premiers jours de grossesse, rapporte-t-il.
Par contre, poursuit-il, d’autres savants tolèrent le recours à l’avortement dans certains cas. Selon eux, tant qu’on n’a pas encore insufflé l’âme à l’être dans le ventre de sa mère victime de viol ou d’inceste, cette dernière peut mettre un terme à sa grossesse, sous réserve de certaines conditions, précise Oustaz Mouhamed Al Amine. « Il ne s’agit pas de mettre un terme à une grossesse parce qu’on en a envie. On tolère l’avortement avant les 120 jours de grossesse dans des cas bien précis. C’est-à-dire quand l’état de santé de la femme enceinte est menacé, ou si la grossesse est la résultante d’un viol ou d’inceste. »
La double peine des victimes
Parmi les nombreuses femmes victimes de viol ou d’inceste, certaines ont recours à l’avortement clandestin, mettant leur vie en danger. En effet, malgré la législation interdisant l’avortement, le recours à des moyens clandestins reste fréquent. Le coût d’un avortement clandestin dans une clinique privée varie entre 300 000 et 500 000 francs CFA, selon un rapport de la FIDH datant de 2014.
La direction de la santé de la mère et de l’enfant du ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré avoir recensé plus de 30.000 cas d’avortement durant l’année 2020, et les avortements à risques représentent la cinquième cause de décès maternels. Environ 50% des admissions en urgence dans les maternités de référence sont liées à un avortement non sécurisé.
Les complications d’un avortement clandestin « posent un problème de santé publique, avec une morbi-mortalité maternelle élevée », nous dit Dr Mamadou Gaye, médecin en spécialisation en gynécologie-obstétrique.
Parmi les complications, il cite les infections utérines comme l’endométrite, les complications liées à des lésions cervicales, utérines (perforations utérines) voire abdominales, les complications liées à une atonie utérine (absence de rétraction utérine), les complications liées à une rétention du produit de conception, ainsi que les complications liées à un surdosage de médicament permettant l’avortement.
Toujours chez les victimes, celles qui n’ont pas pu avorter, tentent dans bien des cas de cacher leur grossesse et se rendent coupables d’infanticide. C’est le cas d’une jeune fille de 18 ans dans la banlieue dakaroise. « J’ai entretenu malgré moi des relations sexuelles avec mon répétiteur qui se sont soldées par une grossesse. Je ne pouvais pas en parler à ma famille par peur d’être chassée de la maison. J’ai accouché chez moi d’un bébé mort-né et ce sont mes cris qui ont alerté mon frère qui m’a acheminée à l’hôpital de Keur Massar », confie la jeune fille en détention provisoire pour infanticide.
Plaidoyers pour faire bouger les lignes
Pour surmonter les obstacles et convaincre les décideurs politiques de se conformer au protocole de Maputo, notamment en intégrant l’article 14 du Protocole dans le droit national afin de garantir une meilleure protection aux survivantes de viol et d’inceste, Ndèye Fatou Diery Diagne préconise la mise en place de stratégies coordonnées impliquant tous les acteurs concernés.
« Par exemple, nous avons décidé de nous former nous-mêmes à la lecture et à la compréhension du Coran ainsi qu’à la jurisprudence islamique afin d’être suffisamment outillées. L’objectif est de ne plus se tourner vers un oustaz ou un imam déjà opposé à l’avortement, mais plutôt d’aller directement à la source pour nous faire notre propre opinion, en étant capables de lire, comprendre et savoir ce que dit le Coran. En procédant ainsi, nous nous rendons compte que l’argumentaire religieux sur la question de l’avortement est assez relatif. », argue-t-elle.
Pour sa part, Aminata Geneviève Sané, qui rappelle que la légalisation de l’avortement constitue un droit fondamental à la santé et à la dignité, exhorte l’État du Sénégal à honorer ses engagements internationaux en appliquant, dans ce cadre, les recommandations du protocole de Maputo ratifié en 2004.
Amadou Sarr, vice-coordonnateur du Comité de plaidoyer pour la santé de la reproduction des femmes et des filles, également connu sous le nom de Task Force, souligne que de nombreuses actions sont entreprises pour sensibiliser, informer et communiquer sur la nécessité de réformer le code pénal. L’objectif est de sauver des vies en autorisant l’avortement médicalisé dans les cas de viol et d’inceste.
Ce Comité, mis en place en 2013 par la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) du ministère de la Santé, a vu le jour à la suite d’une étude sur la mortalité et la morbidité maternelle au Sénégal.
« Nous sommes convaincus que l’État est conscient de ses engagements et soucieux du respect des droits des femmes, en particulier celles victimes de viol et d’inceste, déclare M. Sarr. Autoriser l’avortement médicalisé dans ces cas précis nécessitera certes l’implication de tous, mais surtout une volonté politique forte. Nous restons persuadés que l’État prendra ses responsabilités pour sauver des vies et lutter efficacement contre l’avortement clandestin. »
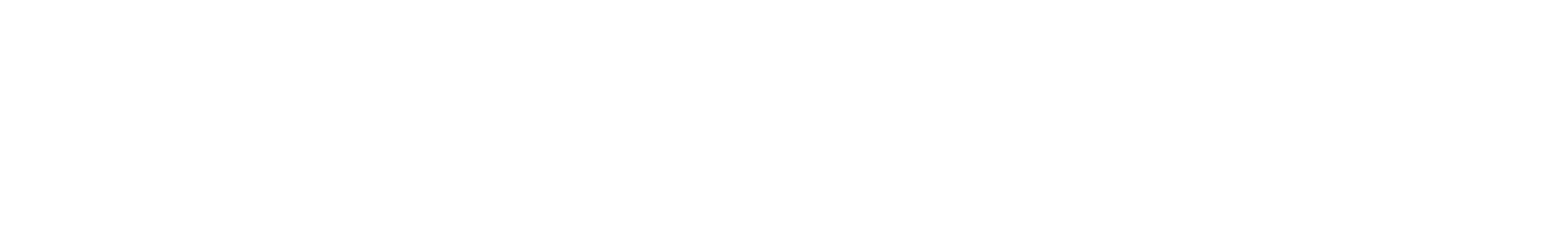







More Stories
REVUE DES TITRES WOLOF DU VENDREDI 14 MARS 2024 AVEC FATIMA ET NDOFFENE
Le discours percutant d’Aissata Tall devant Yacine Fall : « On est pas tout à fait libre… »